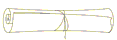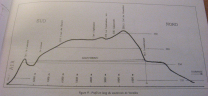D’après l’association Peyrolles Rétro, le début de l’aqueduc serait visible depuis le chemin de la Palunette, à Bastide Thénoux, sous forme d’une petite entrée taillée dans le roc mais plus de trace de la prise d’eau. Voir le montage Dailymotion sur les vestiges

Le premier vestige taillé en plein rocher, ce qui est assez rare dans le monde romain, est proche de la prise d’eau, en bordure de route. Précédé de socles rocheux, il devait comporter un aménagement spécial. L’intérieur du canal est en bon état. Par endroit les concrétions ont disparu, laissant apparaître des pierres taillées en grand appareil.
Pour avoir les mains libres pour travailler, les ouvriers posaient leur lampe à huile dans des petits logements creusés dans la roche à intervalles réguliers. La circulation dans le radier1 y est possible sur plusieurs dizaines de mètres, la hauteur du canal étant d’1m60 environ.
Particularités observées :
- le soubassement des piédroits, construits et s’appuyant au-dessus de la roche taillée, au niveau du radier.
- Un passage étonnant, où l’on trouve successivement l’aqueduc construit entièrement, puis un passage sous une voûte taillée dans la roche, et au bout de quelques mètres, à nouveau la construction. On sait que les ouvrages de type ‘tunnel’ étaient creusés par deux équipes allant à la rencontre l’une de l’autre (exemples célèbres en Algérie à Saldae, et sur l’aqueduc du Gier) selon les principes de Vitruve.
Le plus souvent, sur Peyrolles et Jouques, les vestiges sont des voûtins (portion de voûte) en claveaux, variables en nombre, qui émergent du sol, à peine visibles mais permettent de marquer le tracé de l’aqueduc.
Eléments essentiels pour la construction d’un aqueduc, ces derniers – appelés alors puits sur les tunnels – servirent au moment de la construction, à déterminer le tracé, à vérifier le niveau de la pente, à dégager les déblais et à ventiler les ouvriers ; l’aqueduc en usage, ils permirent son accès afin d’assurer l’entretien de l’ouvrage. JC Litaudon
De nombreux regards2 permettent de contrôler ou de nettoyer la conduite ; rectangulaires, bordés de parois en petit appareil, ils sont toujours soigneusement voûtés en claveaux3, le plus souvent placés de façon régulière tout le long du parcours, tous les 72 mètres ce qui correspondrait à deux actus4, par analogie avec les principes énoncés par Vitruve et Pline l’Ancien (37 à 79 ap, livre XXXI, ch. XXXI) […]: « …il faudra faire des regards de visite tous les deux actus« .
Cette règle a été appliquée à l’aqueduc du Gier à Lyon, en effet une recherche systématique, depuis 1980, en a permis le recensement de près de 90 à ce jour, tous de plan rectangulaire. Selon J.C. Litaudon, ils sont de deux types, en alternance, de petit module (largeur du canal, 0,60 approx.), de grand module (90 x 90), ces derniers ayant un fond plus bas que le radier1 du canal, bac destiné à récupérer les sédiments ; les intervalles entre eux, vont de 68 à 80 m. Mais en zone plane et linéaire, les intervalles sont alors proches de 77m, deux actus romains de 120 pieds.
Ils peuvent être placés également à proximité de points sensibles du parcours comme les ponts de franchissement de vallons. A la verticale de ces regards, on peut observer sur plusieurs aqueducs romains des bacs de décantation pour piéger les fines (impuretés véhiculées par le flux) : cela ne semble pas être le cas de la Traconnade.
Des encoches – opes5 – creusées dans les parois pour l’emplacement d’échafaudages facilitent l’accès au conduit durant la construction. Mais n’étant pas situées en vis à vis, il devait y avoir un autre dispositif mobile pour descendre au niveau du canal.
Le regard le plus difficile d’accès, est profond de plus de 2m ; les opes en vis à vis, sont bien visibles. Un morceau de la dalle de couverture se trouve probablement dans le fond.
Tableau et photos des vestiges de l’aqueduc de Gier, Groupe archéologique Forez-Jarez
Continuer la lecture de Archéologie de l’aqueduc romain de la Traconnade d’après ses vestiges